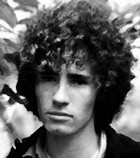 BUCKLEY, Tim : chanteur et guitariste de folk, jazz et rock américain, 1966-1975. Né le 14.02.1947 à Washington (Pennsylvanie. Mort le 29.06.1975 à Santa Monica (Californie).
BUCKLEY, Tim : chanteur et guitariste de folk, jazz et rock américain, 1966-1975. Né le 14.02.1947 à Washington (Pennsylvanie. Mort le 29.06.1975 à Santa Monica (Californie). 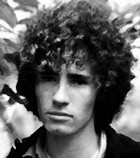 BUCKLEY, Tim : chanteur et guitariste de folk, jazz et rock américain, 1966-1975. Né le 14.02.1947 à Washington (Pennsylvanie. Mort le 29.06.1975 à Santa Monica (Californie).
BUCKLEY, Tim : chanteur et guitariste de folk, jazz et rock américain, 1966-1975. Né le 14.02.1947 à Washington (Pennsylvanie. Mort le 29.06.1975 à Santa Monica (Californie).
Père de Jeff Buckley. Disparu à 28 ans, ce chanteur californien a laissé une des œuvres les plus passionnantes de son temps. Capable de chanter le folk avec une pureté angélique comme de se lancer dans des improvisations issues du free-jazz, Buckley s'est aventuré là où peu de chanteurs se sont risques, grâce à une voix d'une beauté unique en son genre.
Après une enfance passée à new York, Tim Buckley s'installe en 1956 dans le sud de la Californie avec ses parents. Il fait ses débuts vers l'âge de quinze ans comme chanteur et guitariste dans des orchestres de country and western. Vers le milieu des années 60, alors qu'il n'a pas vingt ans, il se produit déjà seul avec sa guitare dans des cabarets folk de Los Angeles. C'est là qu'il est repéré, au début de l'année 1966, par Herb Cohen, le manager de Frank Zappa. Celui-ci organise son premier concert à New York, au Night Owl Café, en juillet de cette année-là. Cette prestation lui vaut aussitôt un contrat avec la firme Elektra, dont la patron, Jac Holzman, coproduit avec Paul Rothchild son premier album, enregistré en trois jours. On découvre sur ce disque son vibrato unique, qui s'allie à merveille avec une orchestration folk-rock et des textes très imagés écrits par son ami Larry Beckett, comme « Valentine Melody » et « Song Slowly Song ». En 1967, sa réputation grandit grâce à des apparitions régulières dans les clubs new yorkais. Il lui arrive de se produire avec Nico, l'ex-chanteuse du Velvet Underground. De passage à New York, George Harrison est subjugué. Il tente vainement d'associer Brian Epstein, le manager des Beatles, à la carrière de Buckley. En novembre 1967 sort l'album Goodbye And Hello, qui comprend l'un de ses morceaux les plus fameux, « Morning Glory ». Le groupe qui l'accompagne alors (et qui reste le meilleur qu'ait jamais eu Buckley) est formé du guitariste Lee Underwood, du contrebassiste Jim Fielder (un vieil ami de Buckley, futur membre de Blood, Sweat And Tears) et du vibraphoniste David Friedman. Les arrangements ont plus originaux et aventureux que sur l'album précédent, et on découvre la liberté rythmique du jazz que Buckley va beaucoup explorer par la suite. L'album Happy – Sad, paru au printemps 1969, marque un tournant. Accompagné des mêmes musiciens, il opte pour des arrangements dépouillés, parfois nus au point de ne révéler que la pulsation rythmique derrière les chansons, comme le très étiré « Gypsy Woman ». Cet album demeure la seule réussite commerciale de sa carrière, relative, puisque le disque n'atteint que le 81 ème place du hit-parade américain. Le disque suivant, Blue Afternoon, publié en février 1970 par le label Straight, poursuit dans la même veine d'un folk-jazz mélancolique. Mais l'album Lorca , que Buckley fournit quelques mois plus tard à son premier label Elektra par obligation contractuelle, s'éloigne des structures de la chanson pour explorer une musique fondée, comme le free-jazz, sur l'improvisation.
Dans l'album Starsailor, qu'il donne aussitôt après, en janvier 1971, à son nouveau label, la voix ne se détache plus, mais fusionne avec le reste, instrument parmi les autres instruments. Buckley place ses deux albums sous l'influence de John Coltrane. C'est sur le second qu'on trouve la chanson « Song To The Siren », reprise en 1983 par le collectif du label britannique 4AD, This Mortal Coil, avec la voix d'Elisabeth Fraser de Cocteau Twins. En 1971, très peu d'amateurs ont suivi Tim Buckley sur ces terres inconnus. En panne d'argent, il est contraint de survivre en faisant des petits boulots. On dit alors qu'il se consacre à l'écriture d'un scénario. Après avoir été chauffeur de taxi, puis un court moment chauffeur pour la superstar du funk Sly Stone, il va émerger à nouveau, à la surprise générale, à la fin 1972, métamorphosé en chanteur funky. Greetings From L.A. est un album très rythmé, avec des cuivres et des percussions, où il s'abandonne, dans ses textes, à une sensualité souvent proche d'une grande crudité sexuelle. Pourtant, il reste un chanteur confidentiel, couvert d'éloges par la critique, mais ignoré du grand public. L'album Sefronia (1973), qui paraît sous la nouvelle étiquette DiscReet, contient de très belles reprises, comme « Sally Go Round The Roses » des Jaynetts ou « Dolphins » de Fred Neil. On y retrouve un peu le Buckley des débuts. Fin 1974, pour conjurer l'échec commercial, il enregistre un album cent pour cent funky, Look At The Fool, tout à fait manqué de l'avis général. Au printemps 1975, il entame une nouvelle tournée américaine. Le 29 juin, il doit être emmené d'urgence à l'hôpital de Santa Monica, près de Los Angeles, après d'être administré chez un ami un cocktail d'héroïne et de morphine qu'il aurait pris par mégarde pour de la cocaïne. Il meurt d'un arrêt du cœur.
Dans les années qui suivent sa mort, son influence reste présente. En 1983, le label californien Rhino publie un excellent Best Of de onze chansons. Surtout, en 1990, le label anglais Demon a l'excellente idée de publier Dream Letter, un double CD enregistré lors d'un concert donnée à Londres en octobre 1968 pour un programme de télévision. Cet album posthume est sans doute le meilleur de Buckley. Avec la beauté aérienne de sa voix, son timbre déchirant et ses improvisations rêveuses, il entraîne l'auditeur dans des contrées inoubliables, servi par un groupe admirable de virtuosité comme de spontanéité. Sa notoriété a pu rester de son vivant, marginale, et sa courte carrière connaître des éclipses, le lyrisme de sa voix comme la liberté de ses orchestrations en ont fait un classique, singulièrement dans le rock dit « indépendant » des années 80 et 90.
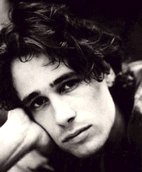 BUCKLEY, Jeff (Jeffrey Scott Buckley) : chanteur et guitariste de rock américain, 1992-1997. Né le 17.11.1966 à Orange County (Californie). Mort le 29.05.1997 à Memphis (Tennessee).
BUCKLEY, Jeff (Jeffrey Scott Buckley) : chanteur et guitariste de rock américain, 1992-1997. Né le 17.11.1966 à Orange County (Californie). Mort le 29.05.1997 à Memphis (Tennessee).
Fils de Tim Buckley. Mort noyé accidentellement à 30 ans dans les eaux boueuses du Mississippi, ce chanteur influencé à la fois par Led Zeppelin, Edith Piaf, les Smiths et l'opéra, était l'un des plus prometteurs de sa génération.
Jeff Buckley ne connaît pas son père. Parti avant la naissance de l'enfant, Tim Buckley ne se manifeste que huit ans plus, soit deux mois avant de mourir d'une overdose. L'enfant est prénommé Scott et adopte le nom de son beau-père, un mécanicien appelé Moorehead. Vivant un temps à Anaheim, la banlieue de Los Angeles où se trouve Disneyland, la famille ne reste jamais longtemps fixée quelque part. De sa mère, une violoncelliste classique, l'enfant apprend le piano ; le beau-père rapporte de nombreux disques à la maison : ceux de Led Zeppelin le frappent le plus. Sous l'influence de Physical Graffiti, il apprend à jouer de la guitare et de l'harmonica. A la maison, il écoute Judy Garland, les Beatles, Joni Mitchell et Mahler. A l'école, il découvre Edith Piaf. Un ami l'initie à l'opéra et lui fait découvrir Benjamin Britten. A 17 ans, après le divorce de sa mère et de son beau-père, il décide de reprendre son vrai nom de Jeff Buckley. Après un premier séjour à New York, il se fixe à Los Angeles où il étudie sans conviction la musique au L.A. Musicians Institute, commençant à jouer de la guitare dans une formation de funk inspirée par Fishbone. Il découvre alors deux groupes qui auront une immense sur lui : les Smiths et Cocteau Twins. Il compose vers le milieu des années 80 ses premières chansons, des versions naissantes de « Last Goodbye » et « Eternal Life » dont il envoie des maquettes à des compagnies de Los Angeles. Sans succès. Il traverse alors une longue période de dépression, écrivant des textes qu'il finira par brûler.
Sa carrière commence à l'ombre de son père disparu. En 1991, il est appelé à New York par Hal Wilner qui lui propose de participer à un concert d'hommage à Tim Buckley. A cette occasion, il rencontre le guitariste Gary Lucas, qui a joué avec Captain Beefheart, et avec qui il travaille à un arrangement de « The King's Chain », une chanson de son père extraite de Sefronia. Ce sera la première et la dernière fois qu'il reprendra une composition de son père, rejetant par la suite toute influence musicale de ce dernier. Il subjugue déjà par sa manière de chanter. Sa voix, couvrant quatre octaves, est modulée comme un instrument, et doit autant à Elisabeth Fraser de Cocteau Twins qu'au maître du qawwali (la musique sacrée des Soufis), Nusrat Fateh Ali Khan. Lucas lui propose aussitôt de se joindre à son groupe, Gods And Monsters. Le temps de tout liquider à Los Angeles, Buckley s'installe à New York, la ville de ses rêves. Mais, après quelques semaines seulement, il quitte Lucas, non sans avoir écrit avec lui « Grace » et « Mojo Pin ». Un agent, George Stein, lui propose de chanter régulièrement seul au Sin-é Café, à St. Mark's Place dans l'East Village, un lieu où chanteurs et chanteuses se produisent dans une ambiance chahuteuse et familiale. Buckley y interprète tout ce qui lui passe par la tête : une chanson d'Edith Piaf, un morceau des MC5, un lied de Mahler ou un chant de Nusrat Fateh Ali Khan, parfois près de cinq heures d'affilée devant vingt personnes. Fin 1992, Columbia lui offre un contrat. Buckley s'associe avec le bassiste Mike Grondahl, qui partage avec lui le goût de l'improvisation, et amène le batteur Matt Johnson. Un premier E.P, Live A Sin-é, le fait connaître : il y chante « Je N'en Connais Pas La Fin » de Piaf, reprend très longuement « The Way Young Lovers Do » de Van Morisson et crée « Eternal Life » et « Mojo Pin ». Avec le producteur Andy Wallace (qui a réalisé le mixage de Nevermind de Nirvana), le trio enregistre à Bearsville, près de Woodstock, le contenu de Grace : l'un des meilleurs premiers albums de l'histoire du rock, un cop de maître à l'impudeur troublante.
Sorti en été 1994, cet album est très marqué par l'influence de Led Zeppelin sur les compositions originales qui mêlent hard rock, vocalises et rythmes orientalisants, avec des progressions d'accords venues du jazz. « Last Goodbye » surtout, « So Real », « Dream Brother », « Lover, You Should've Come Over » et « Mojo Pin » sont splendides. Buckley utilise pourtant mieux toute sa palette vocale quand il reprend les chansons des autres, comme « Hallelujah » de Leonard Cohen, « Lilac Wine » (chanté par Elkie Brooks et connu par l'interprétation de Nina Simone) et le « Corpus Christi Carol » de Benjamin Britten. L'album est accueilli en France avec un enthousiasme particulier, recevant le Grand Prix international du disque. Pour tourner, Buckley s'adjoint un second guitariste, Michael Tighe. L'accueil, en Europe, est proche de l'adulation, et le public chante en chœur avec lui comme au stade. Un de ses concerts suscite l'E.P Live At The Bataclan. Buckley passe toute l'année 1995 et le début 1996 en tournée à travers le monde, après quoi il compose lentement les chansons de son opus suivant, disparaissant fréquemment dans la nature. Fin 1996, il annonce via Internet la sortie prochaine d'un prochain album, My Sweetheart The Drunk, mentionnant aussi des problèmes personnels. Fixé à Memphis, il travaille un temps à ce disque avec le guitariste et producteur Tom Verlaine, avant d'interrompre cette collaboration. Il donne alors des concerts sous divers pseudonymes, puis décide de rassembler son groupe pour enregistrer à nouveau avec Andy Wallace, toujours à Memphis. Le jour où les séances doivent commencer, il ne trouve pas le chemin du studio. D'excellent humeur, il s'installe au bord du Mississippi avec sa guitare et sa radio portable. Il décide de partir se baigner tout habillé en chantant « Whole Lotta Love » qui passe à la radio, gardant ses lourdes bottes aux pieds, laissant son compagnon de promenade sur la berge. Pris par les courants formés par le passage de deux bateaux, il disparaît, noyé. On retrouvera son corps plusieurs jours plus tard. L'autopsie révèlera l'absence d'alcool et de substances toxiques.
Jeff Buckley avait de la musique une approche généreuse : il était ouvert à tous les courants musicaux. Il était capable, en s'appropriant les chansons des autres, d'un lyrisme rare. Ses dons étaient si exceptionnels que ses amis le disaient capable de chanter immédiatement l'intégralité d'un air qu'il venait d'entendre. Un talent rare, bouillonnant, entre puissance et délicatesse. Un lyrisme et un chant libres, sensuels, débridés qui laissaient entrevoir une grande carrière mais la famille était probablement maudite… En mai 1998, Sony-Columbia a publié un double CD, Sketches For My Sweetheart The Drunk, où sont regroupées les maquettes et les chansons inachevées sur lesquelles il travaillait juste avant sa mort.